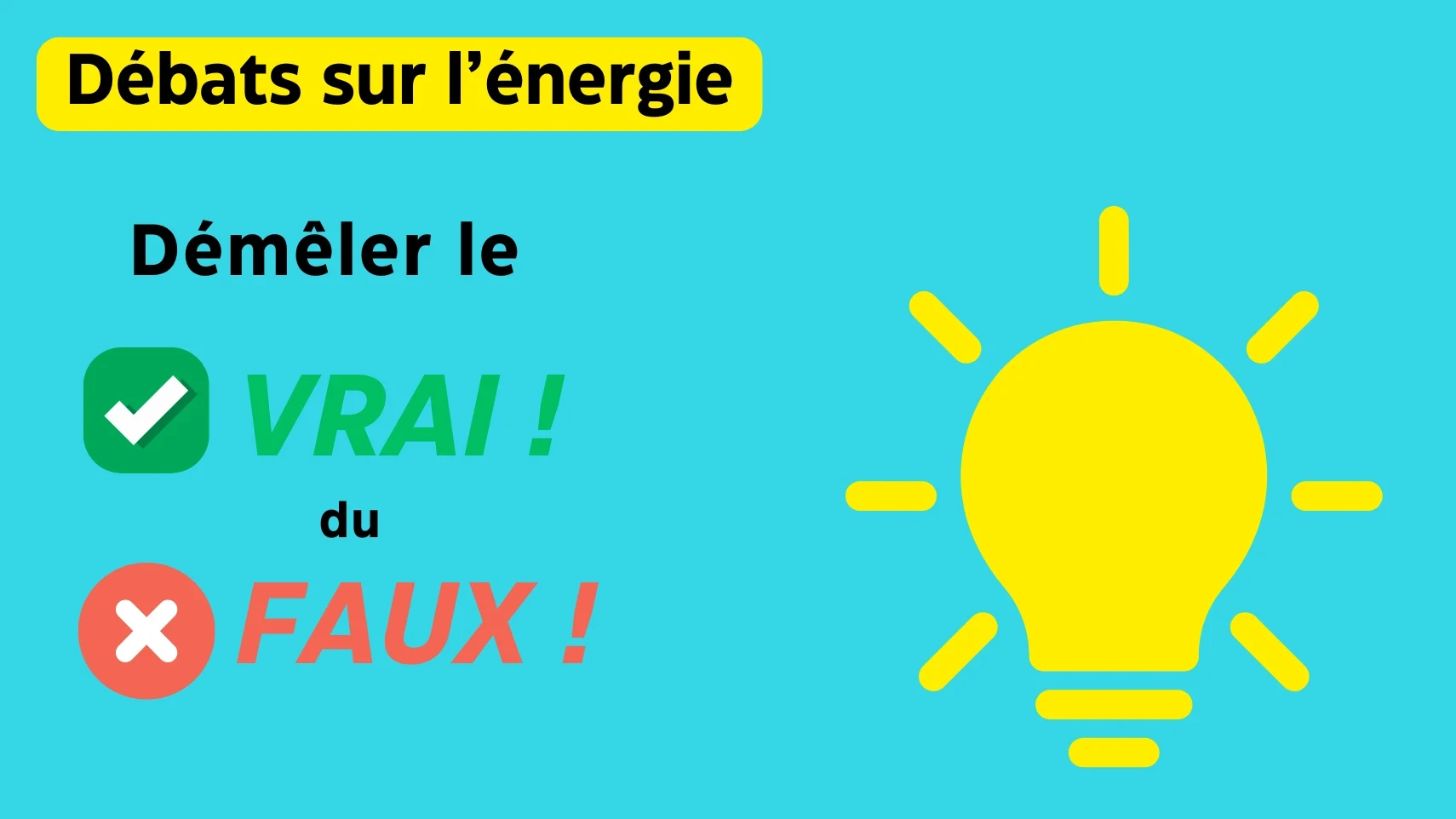Depuis quelques semaines, de nombreuses affirmations et tout autant de chiffres relatifs aux débats sur l’énergie circulent dans les médias. A l’occasion de la rentrée, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) démêle le vrai du faux et publie un document de clarification avec dix questions clés, auxquelles elle apporte des réponses circonstanciées et objectivées […]
Pour en savoir plus, consultez l'actualité du 01/09/2025
Téléchargez le document “Débats sur l'énergie - Démêler le vrai du faux”
ou
consultez les questions-réponses ci-dessous :
La facture moyenne d’électricité a significativement augmenté entre 2015 et 2025 mais elle n’a pas doublé. Si l’on prend en compte le tarif réglementé de vente (TRVE) qui est le contrat d’électricité le plus répandu en France parmi les clients résidentiels (au 31 décembre 2024, on dénombrait 20,2 millions de clients résidentiels au TRVE, soit 58% des clients résidentiels), les tarifs ont augmenté sur la période de 20% en euros constants, soit +45% en euros courants, c’est-à-dire tenant compte de l’inflation. Cette évolution concerne bien l’ensemble de la facture, abonnement et consommation.
Le soutien des énergies renouvelables par l’Etat n’est à ce jour pas directement répercuté sur la facture.
L’augmentation de 20% hors inflation des factures sur les dix dernières années est imputable à un ensemble de facteurs. Les factures d’électricité se décomposent en 3 parties :
la fourniture en électricité (qui représente environ 40% de la facture)
le tarif d’utilisation des réseaux (environ 29%)
les taxes (environ 31%).
Cette répartition a évolué au cours du temps, la part fourniture en électricité ayant notamment augmenté pendant la crise de 2022-2023 (crise d’approvisionnement en gaz et baisse de la production nucléaire due à la corrosion sous contrainte).
Sur la partie fourniture en électricité, les EnR ont plutôt tendance à faire baisser les prix de gros compte tenu de leur coût marginal faible.
Le coût des réseaux est facturé aux clients, notamment résidentiels, au travers du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Celui-ci est fixé par la CRE tous les quatre ans. En 2025, la CRE a déterminé le TURPE 7 pour les années 2025-2028. Après une augmentation en 2025, celui-ci évoluera chaque année de la période à un niveau proche de l’inflation. Ceci permettra de couvrir l’ensemble des investissements, en croissance, des gestionnaires de réseau.
Selon la prévision de la CRE, le TURPE devrait évoluer de manière maitrisée dans les années à venir. Ainsi, la CRE a effectué des calculs de prévisions à long terme, incluant les investissements annoncés par les gestionnaires de réseaux qui amènent à envisager un TURPE en hausse de l’inflation + 1% par an jusqu’à 2040 pour les clients résidentiels.
La réalisation de ces prévisions dépendra de nombreux autres facteurs extérieurs comme les coûts de l’énergie à venir pour les pertes électriques. Les investissements prévus s’ajusteront également en fonction de l’évolution de la demande d’électricité.
Très concrètement, s’agissant des réseaux d’électricité, environ 100 Mds€ d’investissements totaux sont annoncés par RTE (transport) et environ 90 Mds€ par Enedis (distribution) jusqu’en 2040. L’essentiel de ces investissements vise la maintenance, le renouvellement des réseaux existants, le raccordement des consommateurs et des zones industrielles de décarbonation et l’adaptation au changement climatique.
Pour ce qui concerne le raccordement des énergies renouvelables :
environ 18 Mds€ d’investissements sont prévus pour les EnR terrestres, selon les gestionnaires de réseaux – ces raccordements sont en outre partiellement financés par les producteurs eux-mêmes ;
environ 37 Mds€ sont prévus d’ici 2040 pour l’éolien en mer au réseau de transport, la France ayant fait le choix de faire financer l’ensemble des raccordements au travers du TURPE.
Il est important de noter qu’il s’agit de prévisions, qui évolueront en fonction du rythme réel de développement des EnR en lien avec l’électrification de l’économie.
A ces coûts de raccordement s’ajoutent des coûts de renforcement du réseau qui sont en partie liés au développement des énergies renouvelables
S’agissant du soutien public aux énergies renouvelables, les nouveaux engagements nécessaires à l’atteinte des objectifs sont estimés par la CRE à environ 50 Mds€ d’ici 2060, dans un scénario de prix de marché médian.
En additionnant le coût pour les réseaux et le coût du soutien public aux énergies renouvelables électriques, on est donc très loin du chiffre de 300 milliards d’euros. En outre, ces investissements seront étalés sur plusieurs décennies.
Aujourd’hui le développement des EnR est effectivement soutenu par l’Etat puisque de nombreux projets sont éligibles au soutien public (obligation d’achat pour les plus petits projets, complément de rémunération pour les plus conséquents). Ainsi, au titre de 2025, la CRE évalue le soutien public aux énergies renouvelables au titre de 2025 à 6,9 Mds€.
Le coût du soutien dépend essentiellement de deux facteurs : le niveau du tarif d’achat garanti et le niveau des prix de marché. Ainsi, les filières les plus compétitives rapportent à l’Etat lorsque les prix de marché sont élevés. Cela a d’ailleurs été le cas pendant la crise de 2022-2023 : au titre de ces deux années, les EnR électriques ont apporté 5,5 Mds€ de recettes au budget de l’Etat.
Par ailleurs, d’autres types de contrats existent, qui ne reposent pas sur le soutien public. Il s’agit notamment des PPA (power purchase agreement), des contrats entre un producteur et un acheteur, sur une période donnée. La Commission de régulation de l’énergie a récemment publié son premier observatoire relatif à ces contrats dans lequel elle émet une série de recommandations pour accroître leur proportion.
Il est donc vrai que le développement des EnR est soutenu par le budget de l’Etat, et de façon importante lorsque les prix de marché sont bas, mais faux de dire qu’il n’y aurait pas d’autres moyens de les développer.
La prévision de la CRE s’élève à 6,9 Mds€ de soutien aux EnR à compenser en 2025. Si l’on compare aux niveaux observés avant la crise des prix de gros de l’énergie, ce chiffre est légèrement supérieur (6,4 Mds€ en 2020) mais reste relativement stable. Ce retour à des niveaux de charges comparables au titre de 2025 par rapport à 2020 s’explique par :
une légère baisse des charges unitaires (passant de 89,74€/MWh à 85,62€/MWh) – les charges unitaires représentent le coût moyen d’un contrat de soutien ;
contrebalancée par une hausse globale du volume soutenu (de 72 TWh à 81 TWh).
Il est important de noter que le niveau des charges unitaires intègre les contrats photovoltaïques pré-moratoire de 2010 dont le tarif d’achat est particulièrement élevé (plus de 500 €/MWh). Celui-ci concourt aux charges observées à hauteur de près de 2 Mds€ au titre de 2025. La majorité de la puissance contractualisée sur ces contrats arrive à échéance avant 2033, avec un début de décroissance dès 2029.
Pour rappel, entre 2021 et 2024, de fortes variations au niveau des charges liées au soutien aux énergies renouvelables électriques et à la cogénération au gaz naturel ont été constatées en raison principalement des évolutions très fortes des prix de gros de l’électricité et du gaz. Ainsi, les énergies renouvelables électriques ont apporté 5,5 Mds€ de recettes au budget de l’Etat au titre des années 2022 et 2023. A partir de 2024, on observe un retour à la dynamique d’avant crise qui se poursuit en 2025.
Pour en savoir plus sur l’évolution des charges de service public de l’énergie au titre de 2025 : https://www.cre.fr/actualites/toute-lactualite/la-cre-publie-sa-premiere-evaluation-des-charges-de-service-public-de-lenergie-pour-2026-et-sa-reevaluation-pour-2025-confirmation-du-retour-vers-la-dynamique-davant-crise.html
Les charges de service public de l’énergie liées au soutien aux énergies renouvelables viennent compenser la différence entre les tarifs garantis par l’Etat (soit au titre de l’obligation d’achat, soit du complément de rémunération) et les prix des marchés de gros. Dès lors, lorsque les prix observés sur les marchés de gros sont bas, la compensation par le budget de l’Etat est plus importante.
A l’inverse, lorsque les prix observés sur les marchés de gros sont élevés, comme cela a été le cas en 2022 et 2023, la compensation par le budget de l’Etat diminue, et peut même se faire dans l’autre sens. Ainsi, les énergies renouvelables électriques ont contribué au budget de l’Etat et joué un rôle d’amortisseur pendant la crise des prix de gros de l’énergie. Elles ont apporté 5,5 milliards d’euros de recettes au budget de l’Etat au titre des années 2022 et 2023. Au-delà des périodes de crise, les filières les plus compétitives rapportent à l’Etat dès que les prix sont élevés.
A noter, si les prix de marché bas font mécaniquement augmenter les charges à compenser, ils restent une bonne nouvelle pour les Français puisqu’ils contribuent à une baisse de la facture moyenne d’électricité (pour mémoire, les tarifs réglementés de vente d’électricité ont ainsi baissé de 15% au 1er février dernier).
Pour en savoir plus sur les CSPE : Charges de services public de l'énergie
En 2024, l’équilibre offre-demande en France s’est fortement amélioré. La production a atteint 539 TWh, dépassant ainsi la moyenne des années 2014-2019 (avant-crise), avec notamment 362 TWh de nucléaire, 75 TWh d’hydraulique et 72 TWh de production éolienne et photovoltaïque.
Cette production significative a permis à la France d’exporter 89 TWh d’électricité vers ses voisins, générant de l’ordre de 5 Mds€ de recettes pour la balance commerciale nationale. Elle a donc effectivement plus produit qu’elle n’a consommé.
Le solde exportateur positif observé en 2024 (89 TWh) est le résultat de périodes d’exportation (101 TWh exportés) mais également d’importation (12 TWh importés). En effet, à l’échelle d’une année la production comme la consommation ne sont pas constantes. Il est indispensable de pouvoir faire face aux périodes de pointe, moments auxquels la consommation est bien au-delà de la moyenne et atteint ses pics.
Par ailleurs, personne ne saurait garantir que la situation de 2024 se reproduira à l’identique chaque année, comme en a témoigné la crise de 2022, pendant laquelle la France a importé plus d’’électricité (73 TWh) qu’elle n’en a exporté (55 TWh) en raison d’une production moindre liée à la crise de la corrosion sous contrainte du parc nucléaire conjuguée à une production hydraulique plus faible en raison de pluies trop peu abondantes, et a fait face à des prix très élevés.
Surtout, la demande d’électricité est anticipée à la hausse ces prochaines années, conséquence de l’électrification croissante des usages et de l’économie indispensable à la sortie des fossiles et à la baisse des émissions de CO2. Pour y faire face et dans l’attente de la mise en service des nouveaux EPR à partir de 2038, les moyens de production d’énergie renouvelable sont les mieux placés : de taille variée, plus rapides à construire et à mettre en service. Leur développement peut s’ajuster au rythme de l’augmentation réelle de la consommation.
Le rapport publié par les autorités espagnoles conclut que la part des énergies renouvelables dans le mix espagnol n’a pas été la cause du black-out survenu le 28 avril dernier. Il fait état d’une conjonction de facteurs ayant entraîné un phénomène de tension haute, qui n’a pas pu être contrôlé par le réseau.
Par ailleurs, les conclusions des enquêtes techniques européennes seront publiées à l’automne 2025. Elles permettront d’apporter un éclairage supplémentaire.