La CRE publie le rapport de sa Prospective relatif à l’insertion des petits réacteurs modulaires (SMR/AMR) dans les systèmes énergétiques
Communiqué de presse Électricité
Publié le
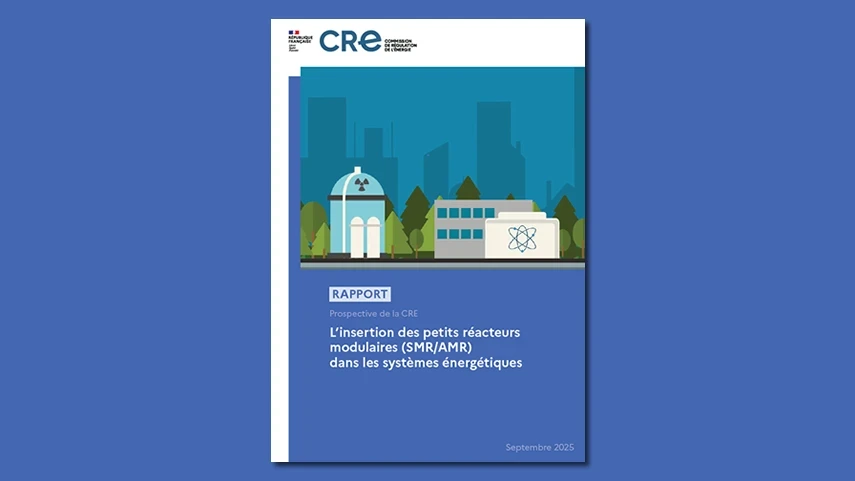
Le 29 avril 2024, la Prospective de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a lancé un nouveau groupe de travail relatif à l’insertion des petits réacteurs modulaires (SMR/AMR) dans les systèmes énergétiques. Ce groupe de travail, co-présidé par Anne-Marie Choho, Directrice Générale de SETEC et François Lévêque, Professeur d’économie à Mines Paris – PSL, a présenté ce jour les principales conclusions de ses travaux lors d’une séance de restitution de son rapport, disponible sur le site de la CRE.
Le développement des petits réacteurs modulaires
Actuellement, de nombreux pays développent des projets de petits réacteurs modulaires (SMR) et de petits réacteurs modulaires avancés (AMR) comme solution de décarbonation de la production de chaleur et d’électricité, aussi bien sur leur territoire qu’à l’export. D’autres pays sont prêts à s’équiper quand la technologie sera disponible à l’échelle industrielle. SMR comme AMR font reposer leur compétitivité sur leur possibilité de modularité, de flexibilité d’usage et sur les effets de série massifs qui permettront d’amortir leurs coûts fixes élevés. A ce jour, même si différents pays (Chine, Russie, Etats-Unis) ont pris de l’avance, aucun n’a toutefois atteint l’effet de série, principalement en raison d’un manque de financement. Un financement significatif par pays, ou mieux à l’échelle européenne, concentré sur quelques projets prometteurs aurait un double effet gagnant pour l’Europe, en délai et en coût. C’est indispensable si l’on veut rattraper le retard et produire sur notre continent.
Le rapport s’interroge sur le chemin à suivre et les actions à entreprendre pour favoriser le déploiement des petits réacteurs modulaires dans les 25 prochaines années. Technologiquement plus matures, les SMR ont le potentiel d’être commercialisés dans les années 2030, tandis que les AMR, qui ont un potentiel d’usages plus large, nécessitent encore de longs travaux de recherche.
La production de chaleur, premier débouché des petits réacteurs modulaires
Au travers des auditions, les membres du groupe de travail ont constaté que les usages les plus prometteurs des SMR en France et dans les pays où l’électricité est déjà décarbonée sont les réseaux de chaleur urbaine et la chaleur industrielle inférieure à 300°C. Pour une même taille de réacteur, la quantité d’énergie produite sous forme de chaleur est deux à trois fois supérieure à celle produite sous forme d’électricité. La production de chaleur donnera donc un prix moindre au kWh et présente de bonnes chances d’atteindre la compétitivité.
Onze recommandations pour concrétiser leur développement
Les membres du groupe de travail ont émis onze recommandations pour concrétiser le développement des petits réacteurs modulaires autour de trois grandes priorités :
1/ À court terme, accélérer et intensifier les efforts publics pour renforcer les chances de réussite de l’industrie française et européenne face à ses grands concurrents
Pour les SMR, cela signifie atteindre rapidement le stade d’industrialisation et de compétitivité à un horizon proche de celui des concurrents internationaux et des autres solutions énergétiques (EnR), à l’échelle européenne
Pour les AMR les plus matures technologiquement, le groupe de travail recommande de déverrouiller les incertitudes sur l’accès à la matière et à la fabrication des combustibles et accélérer le développement pour sécuriser une contribution aux décarbonations les plus difficiles (chaleur > 300°C notamment) à horizon 2040-2050
2/ Anticiper le débat public et la localisation potentielle des unités L’enjeu de l’acceptabilité des SMR/AMR a été identifié par le groupe de travail comme un élément déterminant pour leur déploiement dans un contexte où ceux-ci ne nécessiteront pas toujours l’activation de la Commission nationale du débat public, étant donnés leur taille et le montant des investissements requis.
Il s’agira notamment de prévenir les questions relatives à la dissémination des petits réacteurs et à leur potentielle proximité des lieux d’habitation, au portage des projets par des acteurs parfois peu connus du grand public et enfin, aux risques liés à la co-activité. Dès lors, il est indispensable d’anticiper leur localisation potentielle très en amont pour commencer ce travail de sensibilisation.
3/ À moyen-terme, préparer les formations adaptées aux phases de construction et d’exploitation et intégrer les enjeux de bouclage du cycle
Le groupe de travail a soulevé la question de la disponibilité de compétences pour industrialiser les SMR/AMR une fois les concepts arrivés à maturité technologique. Cela signifie que de nouveaux profils devront préalablement avoir été identifiés et formés, ce qui doit être anticipé à moyen-terme.
Par ailleurs, La gestion des déchets et matières radioactives doit être envisagée dès la phase de conception des projets et les coûts associés intégrés aux coûts globaux des projets. Un travail d’anticipation des modalités, des risques et des capacités d’entreposage des déchets et matières par les producteurs et de leur stockage dans les infrastructures gérées par l’Andra doit être mené.
Pour rappel, la Prospective de la CRE a pour objectif, avec l’appui du Conseil scientifique de la CRE, de rassembler universitaires, experts, dirigeants de centres ou instituts de recherche, économistes ou encore professionnels du secteur de l’énergie, pour réfléchir collectivement pendant 12 à 18 mois sur des thématiques d’avenir. Elle a par exemple publié en septembre 2024 un rapport sur le captage et la chaine de valeur du dioxyde de carbone. Pour en savoir plus sur la Prospective de la CRE
À lire aussi

Didier REBISCHUNG rejoint le Collège de la Commission de régulation de l’énergie
Électricité Gaz
Publié le


